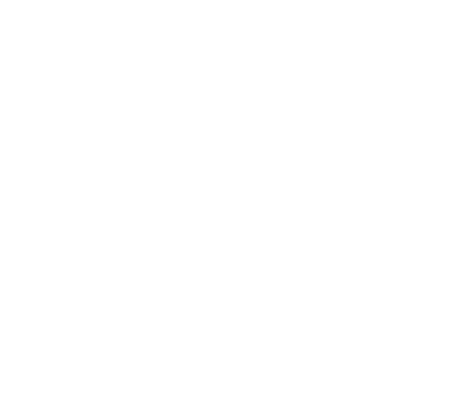Plus que trois décennies après la sortie de son ouvrage Honneur et baraka sur le Rif marocain, Raymond Jamous y revient avec quelque peu de nostalgie et beaucoup de certitudes. Comme si aucun travail anthropologique n’a été fait durant cette période. Comme si l’anthropologie était toujours prisonnière des débats théoriques des années 1970. L’auteur situe, en effet, son tout récent livre, Le sultan des frontières (1), dans le prolongement du premier, non pas pour le confronter aux nouvelles découvertes et approches anthropologiques, mais pour en confirmer la pertinence et l’universalité.
Reprenant un mythe qui lui a été narré lors de son terrain au Rif dans les années 1970, il essaie de le relire au prisme de l’histoire écrite pour évaluer sa thèse concernant, d’une part, l’opposition structuro-fonctionnaliste entre l’honneur et la baraka, et, d’autre part, la centralité du pouvoir sharifien dans la formation de l’identité rifaine et, plus généralement, marocaine. Le mythe raconte, en gros, l’expédition punitive d’un souverain noir imaginaire, que les interlocuteurs de l’auteur identifient à Moulay Ismail, pour venger son père qui fut humilié par la tribu rifaine des Iqar‘in. Usant de ruses et de mensonges, le sultan finit par piller la tribu et tuer tous ses hommes. À son retour à la capitale, il envoie des hommes de l’intérieur du pays pour « épouser » les femmes endeuillées. Ces dernières « transmirent les terres de leurs maris tués aux enfants mâles qu’elles eurent avec les géniteurs de l’extérieur ». C’est pourquoi ces enfants se considèrent en tant qu’« enfants de femmes ».
Ainsi, selon la lecture de Jamous, le sultan, étant le seul à associer dans son action violence et baraka, s’impose comme un facteur central pour la reproduction de la société locale. C’est au prisme de l’histoire globale connue des dynasties marocaines et plus particulièrement des itinérances sultaniennes (harka) que l’auteur élabore son argument. Autrement dit, l’auteur veut inscrire l’expédition punitive du mythe dans l’histoire documentée des expéditions punitives en général. Ainsi, le sultan itinérant serait un saint guerrier en relation, conflictuelle ou pas, avec différentes tribus. En tant que saint, il est le souverain de la baraka qu’il dispense lors de ses campements, lesquels portent tous les symboles et signes de la sainteté : dans sa tente prestigieuse, nommée qobba, il reçoit ziyara et hediya et bénit les visiteurs. En tant que guerrier, il use de violence pour mater les tribus rebelles, celles notamment qui remettent en cause son autorité et les frontières de son pouvoir.
La tribu rifaine des Iqar‘iyin serait l’une de ces dernières, puisqu’elle-même a encouru la colère du sultan itinérant et son extrême violence : massacre des hommes et viol des femmes. Dans ce cas, la baraka se manifeste moins dans une relation d’échange et de bénédiction que dans l’action de viol-ence même. C’est elle qui permet de sacrifier des hommes récalcitrants et d’engrosser leurs femmes pour générer de nouveaux hommes. Une nouvelle société assujettie, dont les membres s’identifient moins à leurs géniteurs effectifs qu’au sultan, leur géniteur symbolique.
Sans doute cette approche pose-t-elle de sérieux problèmes d’ordre méthodologique et théorique. D’une part, l’analyse s’appuie sur des sources essentiellement historico-textuelles pour évaluer la portée historique d’une tradition orale et de la mémoire collective. Certes, un mythe peut dire parfois l’histoire, mais il dit aussi, sinon souvent, le non-écrit de l’histoire, voire la contre-histoire, surtout dans le cas d’une histoire vécue de viol-ence. Autrement dit, l’oralité mythique ne peut se réduire à la textualité historique, comme on ne peut exclure la capacité effective de cet imaginaire à subvertir ces mêmes textes et à en éclairer certaines zones d’ombre qui ont été notamment obscurcies par les conditions politiques de leur production. Mais là Jamous, il le dit lui-même, fait une relecture historique du mythe non pas du point de vue des victimes de la violence, mais à partir d’une perspective « makhzanienne ». L’auteur essentialise ainsi la violence, n’y voyant que le symbolique et le structurel qui permettent la reproduction du social et du culturel. Une lecture borgne qui focalise sur la baraka de la violence et ignore totalement la violence effective de la baraka.
En effet, cette interprétation restrictive que fait Jamous du mythe rappelle l’opposition pour gober l’opposition, souligne le conflit pour exclure le conflit, expose la violence pour lénifier la violence. Le mythe en question ne peut être lu et interprété séparément des autres mythes similaires relatés dans toutes les régions du Maroc, du Rif jusqu’au Sahara. Le mythe a, ce faisant, une importante profondeur géographique qu’il faut sérieusement prendre en considération pour en saisir la profondeur culturelle et politique. Ses différentes variantes ne disent nullement la dichotomie forcée entre « honneur » et « baraka » et n’excluent point l’ancrage tribal du sharifisme sultanien. Mais elles rappellent plutôt la tension et le conflit incessants qui existe entre pouvoir temporel et autorité religieuse et la césure qui s’est établie entre les deux, ainsi que les ambitions politiques, surtout des hommes de Dieu, pour encore associer les deux formes de pouvoir.
Dans la même logique, Jamous entend, d’autre part, remettre en cause la conception khaldounienne du pouvoir et de la succession politique, estimant que le Maroc sharifien nécessite un autre modèle qui prend en considération le changement. Pour Jamous, le changement c’est la transition d’un modèle politique tribal, généralement « cyclique », à un modèle sharifien, continu, dans lequel les tribus ne sont plus tentées par la conquête du pouvoir – tant que c’est le sultan sharif qui définit l’ensemble des rapports sociopolitiques, tant avec les tribus qu’avec les autres lignages sharifiens. Autrement dit, Jamous propose en alternative un modèle de continuité politique où la rupture et le véritable changement sont exclus. L’auteur ignore ici, ou veut l’ignorer, que l’histoire du sharifisme au Maroc, ne commence pas au 16e siècle avec les sharifs zaydanites, mais bien avant. Au 8e siècle déjà, les sharifs idrissides constituèrent la première dynastie dans le Maroc islamique. Jamous n’en souffle pas un mot. Dans son long rappel de l’histoire politique classique du pays, il préfère l’occulter, complètement. Sans doute le fait-il pour que son modèle dichotomique tribal⁄sharifien fonctionne.
En bon socio-historien, Ibn Khaldoun ne pouvait donc, comme le prétend l’auteur, ignorer le modèle politique sharifien, comme il ne pouvait ignorer la force des idées sharifiennes et leur instrumentalisation politique déjà en œuvre à l’époque mérinide. Mais Ibn Khaldoun, contrairement à Jamous, n’essentialise ni idéalise le pouvoir sharifien. Dans sa perspective, celui-ci n’est pas une excroissance sociologique ; il est inscrit dans la dynamique sociale qui préside à tout changement politique, tribal ou non-tribal. Autrement dit, le modèle politique sinusoïdal élaboré par Ibn Khaldoun s’applique tout aussi au pouvoir sharifien. Et comme tout autre forme de pouvoir, celui-ci n’est pas « déterminé mécaniquement », mais il est plutôt l’expression de la confluence de plusieurs facteurs, politique, social, économique, militaire et géographique. L’irritation de l’historien à l’égard des idées idéalistes et essentialistes de ce pouvoir et de ses articulations sociales est palpable dans la critique acerbe qu’il adresse, dans al-Muqaddima, au philosophe Ibn Rushd pour qui le sharaf, cette noblesse généalogique, détermine le social et n’est pas déterminé par lui. Contre cette posture, il élucide, dans un passage d’une actualité anthropologique surprenante, les dimensions essentiellement socio-anthropologiques de la noblesse généalogique, l’inscrivant dans ses imbrications sociales globales. Aussi la noblesse généalogique n’a-t-elle de signification politique que si elle est socialement signifiante. Autrement dit, à l’instar d’une tribu, une lignée sharifienne politiquement influente dans le présent, et ce sont là les propres mots d’Ibn Khadoun, peut ne plus le rester dans l’avenir, si elle n’a plus l’appui social, économique et militaire.
Ainsi, contrairement au modèle reproductif de Jamous, basé sur l’opposition structurelle entre l’honneur (le tribal) et la baraka (le sharaf), le modèle sinusoïdal khaldounien – je dis bien sinusoïdal et non « cyclique » comme l’écrit Jamous – n’implique nullement la reproduction du régime politique, mais l’inéluctabilité du déclin des régimes, quelle que soit leur nature, qui n’ont plus la légitimité sociale. En ce sens, Ibn Khaldoun est plus socio-anthropologue que Jamous et croit plus que lui au changement politique.
(1) Jamours, Raymond. 2017. Le sultan des frontières : essai d’ethnologie historique du Maroc. Nanterre: Société d’ethnologie.